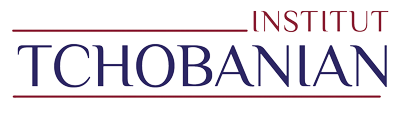Il y a un an je me joignais au groupe des étudiants de l’UFAR guidé par le recteur Jean Marc Lavest au pied du Musée du génocide, pour me rendre ensuite au mémorial afin d’y déposer des fleurs à la mémoire des victimes du « grand crime » perpétré par le gouvernement jeunes-turcs en 1915-1917.
À la veille d’un nouvel anniversaire, le 105e, de cette tragédie qui fut à la fois celle de tout un peuple mais aussi du silence qui longtemps la recouvrit et inspira peut-être hélas celle qui s’ensuivit un quart de siècle plus tard pour un autre peuple, les souvenirs glanés au cours de ce bref retour en Arménie me semblent appartenir à une autre époque. Le monde d’alors était, en dépit de ses convulsions rituelles, un monde vivant qui, jour après jour, continuait sur sa lancée dans l’espoir de devenir meilleur. Le printemps arménien fleurissait avec la démocratie nouvelle dans les rues comme sur le vernissage rénové en quatre allées bien propres où l’artisanat démontre à chaque étal la minutie, le patient labeur et l’inventivité créatrice de ce même peuple qui a, à travers son histoire millénaire, toujours su renaître de ses cendres. Un souffle de brise dans les feuillages encore épars, le son d’un doudouk comme un souvenir plaintif de tant de morts innocents, le claquement des dés dans une partie de trictrac local comme une faculté de s’en remettre au hasard pour mieux le féconder : tel fut le bruit de fond de ce retour à Erevan qui m’inspirait le sentiment que l’Arménie revivait ainsi que, passé le temps des malheurs, elle avait toujours su revivre.
Un an plus tard, notre monde semble s’être arrêté de vivre. Face à un ennemi cette fois invisible qui n’épargne aucun pays, il compte lui aussi ses morts. Dans le confinement qui est le nôtre, quand la tragédie rôde autour de nous, peut-être pouvons-nous mieux comprendre celles que d’autres ont vécues. Un certain 24 avril l’arménité est devenue un enfermement, le virus récurrent de la barbarie s’est répandu à l’échelle d’un empire où il avait déjà sévi au cours des siècles, mais cette fois c’est bien d’une pandémie dont il s’agissait sans autres remèdes que ceux de fuir ou de se cacher. J’ai beaucoup appris, au cours des mois passés, en travaillant sur la destinée de Komitas, l’une des personnalités les plus révérées et sans doute la plus emblématique de l’histoire arménienne récente. Le « grand crime » de 1915, pour reprendre la terminologie de l’époque, ne visait pas seulement l’extermination d’une minorité mais l’anéantissement de sa culture.
Le 24 avril 1915 marque pour Komitas le début d’une dégénérescence de ses capacités créatrices. Cette césure dans sa vie correspond à la rupture du cours de l’histoire pour le peuple arménien, dont la diaspora porte aujourd’hui encore témoignage aux quatre coins du monde. Le mutisme de Komitas ne traduit pas une incapacité de s’exprimer mais la revendication de la dernière liberté à sa portée : le refuge dans le silence et la dignité. Sa façon de témoigner que, désormais, rien ne sera plus comme avant. Pourtant son œuvre, composée en grande partie alors qu’il en parcourait les campagnes, tirée en quelque sorte de la glèbe, de cette terre façonnée par un peuple simple et industrieux, nous reste comme l’écho d’un paradis perdu.
Lorsque nous sortirons nous aussi de notre confinement, après nous être si souvent dit que rien ne sera plus, ne doit plus être comme avant, aurons-nous comme lui le courage de tenir parole ?
Henry Cuny
Ancien ambassadeur, écrivain
Président d’honneur de l’Institut Tchobanian