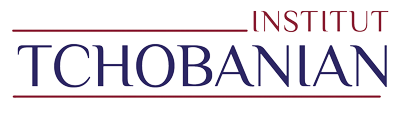Dans un monde en mutation rapide, tous les pays, même les superpuissances mondiales, ajustent rapidement leurs approches géopolitiques pour s’adapter aux défis et aux problèmes contemporains. Les transformations globales des grandes puissances affectent inévitablement les acteurs de taille moyenne et plus petite, qui sont également contraints de faire face à de nouvelles réalités et de changer les règles de leur comportement. Naturellement, tous ne peuvent pas résister à ce processus intense, et certains sont écartés de la compétition, devenant des États en déclin ou en faillite. Seuls ceux qui peuvent naviguer avec précision dans ces processus, évaluer correctement les défis, anticiper les scénarios de changement possibles et mettre en œuvre une politique étrangère adéquate en accord avec les tendances mondiales sortent vainqueurs.
Malheureusement, rien de tout cela ne s’applique à l’Arménie d’aujourd’hui, qui lutte pour trouver sa place dans les transformations mondiales et assurer sa position sous le soleil en construisant un État libre et sûr. De ce point de vue, la situation de l’Arménie est devenue de plus en plus complexe, car elle a cherché simultanément à resserrer ses liens avec l’Occident collectif ces dernières années, mais il s’est avéré que l' »Occident collectif » lui-même n’est pas aussi « collectif » qu’il y paraît. Les tensions entre les États-Unis et l’UE et l’OTAN, associées aux menaces de retrait et aux propositions de création d’un cadre de sécurité européen dirigé par la France et l’Allemagne, ont gravement porté atteinte à l’unité de l’OTAN. Même une réduction de la participation américaine, à moins d’un retrait complet, affaiblirait considérablement la cohésion de l’alliance. Inversement, si Erevan a cherché à resserrer ses liens avec les États-Unis, il a exigé la réciprocité. L’administration Trump doit encore clarifier sa position sur le partenariat stratégique États-Unis-Arménie, une initiative de l’administration Biden visant à réduire la dépendance de l’Arménie à l’égard de la Russie. Compte tenu des priorités divergentes de Trump, l’avenir et les implications pratiques du partenariat restent incertains. Dans le même temps, l’Arménie n’a pas su évaluer correctement la politique de l’administration Trump à l’égard de la Russie. Lorsque le parlement arménien a adopté le projet de loi sur l’euro-intégration en première lecture, quelques heures plus tard, une conversation téléphonique a eu lieu entre Poutine et Trump. En conséquence, les relations entre les États-Unis et l’Europe se sont considérablement détériorées, tandis que les relations entre les États-Unis et la Russie se sont améliorées.
Le virage à l’ouest de l’Arménie a tendu les relations avec la Chine et la Russie. Erevan a évité d’approfondir ses liens avec la Chine, refusant de signer une charte de partenariat stratégique malgré les offres d’investissement de Pékin et les accords similaires avec l’Azerbaïdjan et la Géorgie. L’Arménie n’a pas non plus réussi à s’engager de manière significative dans l’initiative « la Ceinture et la Route », s’attirant ainsi le mécontentement de Pékin. En outre, le fait de rejoindre l’alliance pour la liberté religieuse initiée par Mike Pompeo, perçue comme anti-chinoise, a exacerbé les tensions. En conséquence, la Chine n’a plus d’ambassadeur à Erevan depuis près de huit mois, une situation sans précédent dans leurs relations bilatérales. Quant aux relations arméno-russes, elles sont actuellement tendues, marquées par une tension sans précédent et une rhétorique irrespectueuse de la part de hauts responsables. Cette négativité se reflète également dans les relations de l’Arménie avec l’Union économique eurasienne (EAEU) ainsi qu’avec l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC).
En ce qui concerne les relations de l’Arménie avec ses autres voisins, il semble qu’Erevan ne parvienne pas à normaliser ses relations avec Bakou et Ankara, bien que Pashinyan ait rempli toutes leurs conditions préalables sans exception, faisant toutes les concessions possibles au nom de la normalisation – mais une résolution n’est toujours pas en vue. Quant à l’Iran, les relations avec Téhéran ne sont pas non plus tout à fait sereines, surtout si l’on considère que l’Iran reste le seul pays à s’opposer ouvertement à l’existence du projet de corridor turco-azerbaïdjanais qui traverse l’Arménie. En ce qui concerne la Géorgie, pays d’une importance vitale pour l’Arménie, elle met clairement en œuvre des changements de politique étrangère pour s’adapter aux changements mondiaux. Après avoir surmonté de nombreuses difficultés, la Géorgie semble avoir adopté une stratégie bien définie visant à maintenir des relations équilibrées avec tous les acteurs mondiaux, y compris la Russie, avec laquelle ses relations étaient auparavant désastreuses. Malheureusement, malgré certaines similitudes, l’Arménie n’a pas été en mesure de comprendre, d’interpréter ou d’adopter l’approche de la Géorgie en termes de maintien des relations avec les principaux acteurs mondiaux.
On pourrait croire que les relations de l’Arménie avec l’Inde ou la France sont au beau fixe et que ces pays font de l’Arménie un acteur sérieux dans le Caucase du Sud en lui fournissant des armes. Mais ce n’est pas le cas. S’il est effectivement important que l’Arménie soit en mesure d’acquérir des équipements militaires auprès de nouveaux marchés tels que la France et l’Inde, ces acquisitions répondent à peine aux besoins minimaux de l’armée arménienne, compte tenu des défis mondiaux auxquels l’Arménie est confrontée aujourd’hui. Ces fournitures sont largement symboliques et ne peuvent être considérées comme des livraisons d’équipements militaires en quantités suffisantes pour permettre aux forces armées arméniennes de contrer une éventuelle agression azerbaïdjanaise.
Tous les faits susmentionnés indiquent l’incapacité du gouvernement arménien à gérer le front extérieur, ce qui a un impact significatif sur les processus politiques intérieurs. Un environnement instable et peu sûr représente un défi supplémentaire pour les investissements étrangers, dont le volume reste relativement faible et bien en deçà des niveaux promis par la révolution de Pashinyan. Par conséquent, on peut affirmer fermement que la politique étrangère de l’Arménie a échoué sur tous les fronts et que le pays n’a obtenu aucun succès significatif ou tangible en matière de politique étrangère depuis 2018.