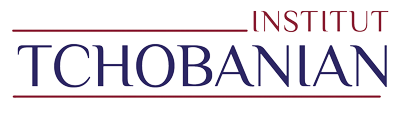Par Ararat Petrosyan
Tragédie à Khojaly – 33 ans après : La responsabilité de l’Azerbaïdjan dans l’assassinat de son propre peuple
Aujourd’hui, 26 février 2025, marque le 33e anniversaire de l’un des chapitres les plus tragiques du conflit du Haut-Karabakh : la tragédie du village de Khojaly, situé dans le Haut-Karabakh. Dans la nuit d’hiver du 25 au 26 février 1992, plus de 600 civils azerbaïdjanais, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont morts dans une fuite chaotique en tentant d’évacuer le village vers Agdam, qui était sous le contrôle de groupes paramilitaires armés azerbaïdjanais. Cette catastrophe, qui a coûté la vie à des centaines d’innocents, est le résultat direct et inévitable d’années de politique des autorités azerbaïdjanaises visant à intensifier la violence, à violer systématiquement les droits de l’homme et à ignorer sciemment les normes internationales, comme le confirme une analyse détaillée présentée dans le rapport d’Helsinki Watch de juillet 1993.
Le village de Khojaly, situé à seulement 10 kilomètres de Stepanakert – la capitale de la République du Haut-Karabakh – avait été transformé par les autorités azerbaïdjanaises, au début de l’année 1992, en un point d’appui militaire pour le bombardement systématique des territoires arméniens voisins et de la capitale, Stepanakert. Selon le rapport d’Helsinki Watch, les forces azerbaïdjanaises, les unités de l’armée nationale et l’OMON ont déployé des armes lourdes telles que des lance-roquettes multiples Grad, des systèmes de missiles et de l’artillerie à Khojaly, ce qui a conduit à des attaques massives contre la population civile de la région, exacerbant la crise humanitaire (pp. 4, 11). Le point d’appui créé par Bakou a provoqué des actions de représailles de la part des forces d’autodéfense arméniennes et a mis en danger sa propre population civile, ce qui a jeté les bases de l’offensive de février 1992.
Les origines de Khojaly remontent aux actions des autorités azerbaïdjanaises qui ont commencé en 1988 lorsque les justes revendications des Arméniens du Haut-Karabakh ont entraîné une vague de violence déclenchée par les provocations perfides des nationalistes azerbaïdjanais. Comme l’indique le rapport d’Helsinki Watch, entre 1988 et 1990, quelque 167 000 Azerbaïdjanais ont été contraints de quitter l’Arménie à la suite de nettoyages ethniques et de provocations organisés par les autorités de Bakou, ce qui a compromis la stabilité de la région et préparé le terrain pour les tragédies ultérieures (p. 3). Ces actions ont marqué le début d’une chaîne d’événements qui a conduit à un conflit armé, que l’Azerbaïdjan a sciemment exacerbé en ignorant les appels à la paix lancés par la communauté internationale.
La mise en œuvre de l’opération « Ring » en 1991, organisée par les unités azerbaïdjanaises de l’OMON en collaboration avec des unités de l’armée soviétique, a marqué une étape décisive dans l’escalade. Officiellement destinée à « identifier les terroristes » et à prévenir les « actions armées de masse », cette opération a effectivement conduit à la déportation forcée de milliers d’Arméniens du Haut-Karabakh et des districts azerbaïdjanais adjacents, ainsi qu’à l’arrestation et à la détention de centaines d’hommes. Les actions agressives lancées par Bakou ont créé les conditions nécessaires pour que les forces arméniennes prennent des mesures de rétorsion, ce qui a rendu l’attaque de Khojaly inévitable.
Après l’effondrement de l’Union soviétique en décembre 1991, les autorités azerbaïdjanaises, profitant du chaos qui s’en est suivi, ont formé leurs propres forces armées et ont eu accès à l’ancien arsenal soviétique. Elles ont saisi de l’artillerie lourde, des systèmes de missiles, des avions Su-25 et d’autres types d’armes, ce qui a considérablement renforcé la capacité de Bakou à mener des opérations militaires agressives contre la population du Haut-Karabakh (p. 4). Au cours de l’hiver et du printemps 1992, les forces arméniennes, se défendant contre les attaques, ont lancé une offensive qui a libéré la quasi-totalité du Haut-Karabakh en mai 1992, y compris les positions stratégiques de Chouchi et de Lachin. Cependant, c’est précisément la politique imprudente et agressive de l’Azerbaïdjan, utilisant Khojaly comme base militaire, qui a mis en péril la sécurité de ses propres réfugiés, conduisant, selon le ministère azerbaïdjanais de la défense, au chaos, à des pertes massives et, en particulier, à la tragédie de Khojaly (p. 4).
Le rapport d’Helsinki Watch de juillet 1993 fournit des preuves irréfutables que les forces azerbaïdjanaises, par des tirs d’artillerie et des frappes aériennes aveugles sur des cibles civiles dans le Haut-Karabakh, ont systématiquement violé les normes internationales, y compris les conventions de Genève de 1949. En particulier, le document indique que, tout en contrôlant la ville de Shusi, les forces azerbaïdjanaises ont bombardé Stepanakert avec des systèmes Grad et de l’artillerie lourde, touchant des civils, des zones résidentielles, des hôpitaux et d’autres objets, ce qui a fait partie d’une politique délibérée d’intimidation et de déplacement (p. 11).
Ces actions inhumaines, visant à intensifier la violence, ont intensifié le conflit et créé les conditions pour des opérations de représailles de la part des forces arméniennes. À Khojaly, par exemple, les autorités azerbaïdjanaises n’ont fait aucun effort pour protéger leur propre population.
À partir de juin 1992, pendant la contre-offensive, les forces azerbaïdjanaises ont utilisé des avions Su-25, pilotés notamment par des pilotes mercenaires russes, pour bombarder et pilonner des dizaines de villages et de villes du Haut-Karabakh, en utilisant des systèmes de missiles imprécis tels que Grad et des bombes à fragmentation qui ont inévitablement touché des cibles civiles, causant des souffrances disproportionnées au sein de la population civile (pp. 11-12). Helsinki Watch décrit ces actions comme « imprudentes et aveugles », visant à intimider et à déplacer les civils arméniens, directement liées aux conséquences de Khojaly, où l’évacuation chaotique a entraîné la mort de plus de 600 personnes (p. 11).
Le nombre de victimes parmi les civils arméniens entre juin 1992 et janvier 1993 a été estimé à 1 500, résultat des actions agressives des forces azerbaïdjanaises utilisant des méthodes destructrices telles que les bombes de 500 kilogrammes et les bombes à fragmentation qui ont détruit des agglomérations entières sans faire de distinction entre les cibles militaires et civiles (pp. 11-12).
Dans le cas de Khojaly, où les autorités azerbaïdjanaises n’ont pas organisé d’évacuation efficace malgré les avertissements de la partie arménienne concernant l’imminence de l’offensive, ces actions ont entraîné la mort massive de civils, dont les corps ont été retrouvés présentant des signes de violence sur la route d’Agdam. Ces actions sont le résultat direct de la politique de Bakou d’escalade de la violence et d’ignorance consciente des droits de l’homme.
Outre les actions militaires, les autorités azerbaïdjanaises ont, depuis 1989 et plus particulièrement depuis l’automne 1991, imposé un blocus complet des lignes de chemin de fer, du pétrole, du gaz et d’autres fournitures vitales à l’Arménie, ce qui a dévasté l’économie du pays voisin, provoqué des troubles sociaux, une pauvreté massive et une crise humanitaire, contribuant indirectement à la déstabilisation de la région et à des tragédies telles que celle de Khojaly (pp. 5-6). Le blocus, soutenu par les partenaires commerciaux de l’Azerbaïdjan, dont la Turquie, a rendu impossible la fourniture d’une aide humanitaire opportune et l’évacuation de la population civile et des résidents de Khojaly, exacerbant les conséquences du conflit.
Le blocus de la République autonome du Nakhitchevan, que l’Azerbaïdjan accuse l’Arménie d’avoir organisé, a également été le résultat des actions de Bakou, bloquant les voies de transport à travers l’Arménie, ce qui a encore aggravé les souffrances de la population et créé des obstacles supplémentaires aux opérations humanitaires qui auraient pu empêcher la tragédie de Khojaly (p. 7). L’Azerbaïdjan a encouragé ses partenaires commerciaux, dont la Turquie, à maintenir cette pression, rendant impossible la sécurité et le sauvetage des civils à un moment critique (p. 6).
Sur la scène internationale, les autorités azerbaïdjanaises ont fait preuve d’un refus total de s’engager dans un règlement pacifique, ce qui a été un facteur supplémentaire conduisant à la tragédie de Khojaly. Au cours des négociations menées sous l’égide de l’OSCE à Rome durant l’été 1992, les représentants de la communauté internationale ont condamné le bombardement du Haut-Karabakh par les forces azerbaïdjanaises, ce qui a suscité de sérieux doutes quant à l’engagement de Bakou en faveur du processus de paix (p. 7). En avril 1993, les négociateurs azerbaïdjanais ont quitté les pourparlers, accusant l’Arménie de tenter de s’emparer du territoire azerbaïdjanais, ce qui empêchait l’instauration d’un cessez-le-feu et la prévention de tragédies similaires, comme celle de Khojaly (p. 7).
En outre, l’Azerbaïdjan s’est catégoriquement opposé à l’intervention de l’ONU, entravant les efforts internationaux visant à résoudre le conflit et à enquêter sur les violations des droits de l’homme, y compris les événements de Khojaly (p. 8). Helsinki Watch, tout en restant neutre, souligne que les actions des forces azerbaïdjanaises, y compris l’utilisation de pilotes mercenaires et d’armes lourdes, visaient à intensifier la violence et à intimider la population, entraînant des conséquences catastrophiques telles que la tragédie de Khojaly (p. 11). Le manque d’accès des experts indépendants à la région, dû à la poursuite des hostilités initiées par Bakou, n’a pas permis de mener une enquête objective, mais le rapport met clairement en évidence des violations systématiques dont les autorités azerbaïdjanaises portent l’entière responsabilité (p. 11).
Source :
https://x.com/araratpetrosian/status/1894654747065438696