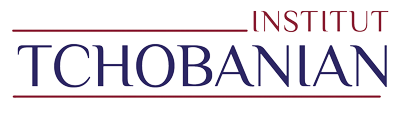Réflexion
J’imagine déjà les froncements de sourcils de ceux, trop nombreux, qui ne s’appesantissent pas sur les mots et n’ont pas coutume de faire dans la nuance. Les mots sont cependant le privilège de l’humain et les nuances le passeport de la vie. Les maux d’une société ont besoin de mots pour les décrire et, partant, commencer à les guérir. Quant à ignorer les nuances, auxquelles ne se prêtent ni les tweets, ni les blogs et autres envahisseurs d’humeurs et d’actualité, cela revient à réduire la pensée à la binarité d’un « pour ou contre », à un squelette dépourvu de chair, à la mort de tout consensus social. Or nous sommes des êtres sociaux.
Mais multi– et pluri-, me direz-vous : n’est-ce pas la même chose ? Nos professeurs, ceux de mon temps en tout cas (et pourquoi n’en irait-il pas de même au temps présent ?) m’ont toujours appris qu’en français les synonymes demeuraient approximation et que deux mots ne signifiaient jamais exactement la même chose. Alors, attardons-nous un instant sur ces deux préfixes.
Multi– vient du latin multus, « beaucoup », « nombreux » (ex : multicellulaire, composé de nombreuses cellules). On le retrouve dans multiple : qui est composé de plusieurs éléments de nature différente. Ce préfixe met en lumière la différence.
Pluri– vient du latin plures, « plusieurs » (ex : pluriflore se dit d’une inflorescence à plusieurs fleurs). On le retrouve dans pluriel, dans plurivalent (logique qui admet plus de deux valeurs de vérité). Ce préfixe est un augmentatif.
L’actualité et ses commentateurs nous abreuvent au quotidien de considérations sur la « société multiculturelle » vers laquelle, que ce soit pour s’en réjouir ou le déplorer, nous serions censés nous acheminer, sans s’interroger sur les messages sous-jacents de déconstruction potentielle d’une identité nationale ou, de façon plus large, civilisationnelle.
Et, de fait, l’histoire nous enseigne la fragilité de ces sociétés multiculturelles qui sont fruit soit de migrations, libres ou forcées, soit de conquêtes impériales. Je m’en tiendrai aux deux exemples que j’ai connus.
Des Etats-Unis, on a parfois affirmé qu’ils étaient composés « d’une majorité de minorités ». Ils n’ont rien en effet du « melting pot » souvent invoqué et je garde en mémoire, lors de ma découverte de ce grand pays en 1970 à l’occasion d’une assemblée générale de l’ONU, ces frontières invisibles quadrillant Manhattan et interdisant aux « Blancs » de s’aventurer au nord de la 96ème rue en direction de Harlem. Outrepasser ces limites revenait à prendre des risques inconsidérés, voire mortels. Le prétendu « creuset » évoquait davantage un chaudron bouillonnant, mitonné par un passé de ségrégation et la persistance de pratiques discriminatoires, de préjugés raciaux qui perdurent encore ainsi qu’en témoigne l’actualité récente. Multiculturelle, la société américaine l’est sans doute, mais par juxtaposition, dans le meilleur des cas par emprunt (ainsi le jazz, aux origines africaines revisitées), non par fusion. Ce modèle ne saurait être le nôtre.

Héritière des empires tsariste puis soviétique, l’immense Russie offre un modèle différent. La diversité ethnique, linguistique, religieuse a été – en suscitant les oppositions – un instrument de conquête du pouvoir tsariste. Staline a poursuivi d’une autre manière cette politique en veillant à l’hétérogénéité des diverses républiques soviétiques dont toute tentative de sécession pouvait être contrôlée par le réveil des minorités incluses qui n’eussent pas manqué de faire appel à Moscou. Les deux guerres de Tchétchénie, à la charnière des XXème et XXIème siècles, témoignent toujours de cette logique impériale, tandis que l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ex-républiques soviétiques, continuent de s’affronter sur la question du Haut-Karabagh et du Nakhitchevan, se focalisant sur les problèmes de droits des minorités et de discontinuité territoriale. Le multiculturalisme, même si l’époque soviétique a été une période d’alphabétisation durant laquelle de nombreux idiomes qui n’avaient jamais été écrits ont reçu leur alphabet, est resté une arme entre les mains du Kremlin et le développement de littératures nationales, souvent mis en avant à l’époque, avait pour corollaire leur totale soumission aux exigences idéologiques du pouvoir. Ce modèle n’appartient pas à la démocratie.
Cette école doit, dès le premier âge, se recentrer sur les fondamentaux qui font entrer l’enfant venu d’ailleurs ou né de l’immigration de plein pied dans la communication avec l’autre et dans l’histoire du pays.
L’exigence en matière d’apprentissage du français ne vaut pas en soi assimilation culturelle, elle est seulement le premier pas vers l’intégration qui ne signifie pas autre chose que l’accession pleine et entière à la qualité de citoyen de notre pays en termes de droits comme de devoirs. Elle est aussi le premier outil de défense de l’identité propre de chacun, une accession au bien commun de la pensée partagée et donc valorisée et enrichie : valorisée vis à vis des autres (puisque formulée sur un pied d’égalité) et enrichie de celle des autres (puisque ouverte à la discussion et au partage). La persistance à l’entrée au collège, voire bien plus tard, d’une orthographe et d’une grammaire déficientes, est un ghetto invisible qui, loin d’être nécessairement lié à l’origine étrangère ou sociale de l’enfant, risque de constituer pour lui un enfermement à vie. Cette maîtrise nécessaire de notre langue n’est pas exclusive de l’apprentissage et du perfectionnement d’une langue familiale qui doit être ressenti et présenté comme un atout précieux pour l’avenir dans la perspective de carrières de plus en plus mondialisées. Espagnol ou portugais ouvrent au regard de vastes espaces vers l’Amérique ou l’Afrique, langues slaves vers cette Europe élargie encore en construction, langues maghrébines vers l’arabe littéraire et les richesses d’une pensée et d’une culture plus prolifique, rayonnante, compréhensive et séduisante que celle de maints prédicateurs de tous horizons… L’exigence assumée en matière de français aura tôt ou tard son corollaire revendiqué en matière de langue domestique. L’enseignement républicain doit nourrir la curiosité pour le monde extérieur et participer ainsi au décloisonnement identitaire (qui est tout le contraire de « l’assimilation » si l’on entend par ce mot le gommage de l’altérité : l’altérité est par définition l’essence même de la démocratie).
Le second pilier d’une adhésion à ce que nous sommes est une compréhension de notre présent en tant qu’aboutissement non figé de notre histoire. Il en va de l’histoire nationale comme de l’histoire personnelle. Nous sommes d’abord notre passé, c’est à partir de lui que nous appréhendons le présent et nous tournons vers l’avenir. Pour que l’école soit une rencontre, en particulier pour les enfants venus d’ailleurs, elle doit expliquer d’où nous venons. Le talent de l’enseignant devrait être de faire de l’histoire de France, en commençant par l’enseignement primaire, l’équivalent d’une bande dessinée qui, de semaine en semaine, d’aventures en aventures, de drames en victoires, de lassitudes en espérances, donnerait les clefs du présent et les rendrait assez précieuses pour toute une vie. Une place particulière devrait être dévolue, au fur et à mesure des degrés d’enseignement, aux institutions, à la philosophie qui les sous-tendait, à cette progression chronologique des idées qui les rend à la fois légitimes et perfectibles. Bref, une autre forme d’instruction civique, tirée de l’expérience plutôt que d’une morale qui, en fonction de la diversité d’une classe, d’un auditoire, peut être ressentie comme clivante.
L’initiation à la musique dès le plus jeune âge, de plus en plus pratiquée, est également un excellent moyen d’abolition des frontières, de participation collective, une défense contre les interdits futurs. Elle touche à l’universel, peut offrir des moments de partage avec les cultures étrangères -à travers les formes musicales, les chants, les danses, le folklore, les instruments – en fonction des origines des élèves d’une même classe. La musique est par essence décloisonnement de l’identité : elle l’abolit en la révélant.
Certes l’école ne peut pas tout, l’éducation parentale reste primordiale, mais l’école peut beaucoup si elle est fidèle à notre devise et pour autant que la liberté d’expression – que seule permet la maîtrise grammaticale – s’y veuille égalitaire et fraternelle.
D’aucuns diront que ce modèle idéal ne peut exister. J’ai pourtant en tête chez nous – encore une fois je ne parle que d’expérience vécue et non par ouï-dire – ces écoles arméniennes, où dès le C.P. les enfants commencent leur journée par la Marseillaise et l’hymne national arménien, dans cet ordre, honorent les deux drapeaux et s’initient conjointement aux deux alphabets si différents. Français et Arméniens, ils ne le sont pas à demi mais à 100 % l’un et l’autre. Pluriculturels par excellence, mais – à l’image de cette diaspora et elle n’est pas la seule – unanimement citoyens de France.
(Cet article publié en octobre 2021 in Europe & Orient n°33, n’est pas lié aux événements actuels, mais les anticipait. Dans l’esprit de cet article vous lirez avec un vrai bonheur à partager autour de vous : Les ciels de Raphaël : lettres à mon petit-fils pour lui faire aimer la France et sa langue.)